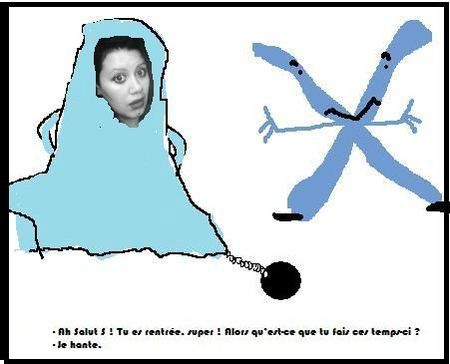Salut à tous! Bon, Comme vous ne le savez peut-être pas, (malgré mes nombreux hurlements virtuels pour vous dire que J'ECRIS!!!) j'écris en relative abondance ces derniers temps. Les trames se clarifient, je vois plus ou moins où ça risque d'aller, mais malheureusement/ heureusement il y a encore bien de l'ouvrage mes ptits vieux. En attendant, je vous donne à lire mes palimpsestes et mon fouilli, petit bout par petit bout.
Donc. Si vous voulez la scène juste avant celle que vous vous apprêtez à lire c'est là, l'épisode de l'oeuf dur.
Désolé du cafouillage et de l'antilinéarité de votre lecture, je vous promets que tôt ou tard je ferai le ménage dand mon blog.
En attendant, je lis lis lis, j'écris, j'écris, j'écris et ça me plait.
Continuez de ne pas vous moucher dans des torchons, on est des gens biens, ici.
Bien cérémonieusement,
S.
. . .
… je tire un coup sur mon bonnet. Fait froid. Le vent fait pas semblant ce soir. Je pense aux petites fesses rondes de T. Pense à ma mutilation surprise au dessous de la pommette.
J’allume une Camel.
Comment est-ce que je vais me démerder pour effacer ce truc ?
Mon problème c’est que j’ai une gueule d’ange à qui on donnerait le Bon Dieu sans concession. J’ai développé une adaptabilité caméléonesque dans l’art de masquer mon don pour getting in trouble.
-Hey salut Shay ! Ca va ?
- Ah ouai! Salut.
CASE
Je tire sur ma clope et continue ma route. Aucune idée de qui est en train de me parler . Mec entre 17 et 33 ans. Il est pas mal. Ressemble à la plupart des mecs de Sanf entre 17 et 33 ans. Dans leur volonté d’originalité/de s’en contrefoutre, les humains de ma génération ont fini par tous se ressembler. On est un creuset d’interchangeables. Idées interchangeables, goûts interchangeables, modes d’expression interchangeables, discours interchangeables, phases de l’existence interchangeables. Finalement, ‘z’ont pas fait un sale boulot de programmation. On se croit suffisamment uniques pour pas s’entre-bouffer et suffisamment-similaires pour pas s’entre bouffer non plus. Et c’est quand un des “individus” penche un peu trop d’un côté de la balance que ça commence à faire des étincelles et du gloubiboulga. Seulement une certaine zone du continuum unique/similaire est habitable. Un peu trop à gauche, un peu trop à droite et c’est bienvenu dans le Livre de la Jungle ! Mais moi je pense que le problème c’est pas nous. C’est le continuum. Si on y réfléchit. Les vrais gens bien, Nabokov, Bukowski, Radiohead, Woolf, Allen, ce sont ceux qui ont foutu le feu au continuum. Qui ont dit MERDE au continuum. Qui ont passé un coup de Mr Propre sur le continuum. Qui s’en sont moqué, qui ont envoyé valsé les trucs en tocs et les cages dorées du continuum. Et qui ne s’emmerde pas à jouer à un jeu de mikado ridicule entre unicité et ressemblance . It’s them who don’t think the same.
J’arrive pas à croire qu’il fasse si froid.
La carte de France, bon dieu. C’est pas comme si j’étais parti à la dérive sur les eaux du Mississipi avec un baluchon et quelques idées racistes pour bagage. Je suis partie parce que je suis l’élite d’une nation qui ne veut pas de son élite. Y’avait trop de cases et je me suis épuisée à essayer de rentrer dans toutes, alors que vraiment je n’appartenais à aucune. Et donc me voilà en plein mois d’août, affamée, emmitouflée, tatouée et très probablement déshydratée, sur la côte ouest américaine, ignare de ce que je cherche, mais bien consciente de ce que j’ai fui. J’ai 26 ans. Pour beaucoup d’entre ceux qui ont trouvé leur case, c’est vieux. Pour les autres, les décasés, ça n’a pas grande signification.
Entre casé et décasé, ce sont deux systèmes de pensée qui s’affrontent. Le casé regarde le décasé et il pense en terme de « sans ».
Sans conjoint. Sans meubles Ikéa. Sans 206. Sans points retraite. Sans complémentaire santé. Sans congés payés. Sans RTT. Sans opinion politique. Sans responsabilité civique. Sans congé parental. Sans joie d’être parents. Sans siège-auto. Sans, sans, sans.
Le décasé ne peut penser le casé que comme un être qui réveille l’« avec »: en lui.
Avec un léger dégoût pour la mécanique grise de son existence. Avec révolte contre son incapacité à prendre conscience de la machine dans laquelle il est pris. Avec démesure et lucidité dans son entreprise de ne jamais passer dans le clan des casés.
Et moi, ma case de décasée c’est celle exaltante et absurde de la dépaysée.
Bref. Tout ça, c’est loin d’être facile. Ma vie de débauche et de clichés c’est comme un mini-ring ou je m’esquive, me flanque des crochets maladroits, des droites bien senties et parfois même me fout k.o. Et quand je suis k.o, je finis avec la France tatouée sur la joue, comme le nez au beau milieu de la figure de style. Littéralement.
Je sais pas combien de blocs j’ai parcourus comme ça, mais j’ai toujours la dalle et que je suis à court de cigarettes.
Ding-dong. Corner store typique. Tellement typique que, comme partout sur la planète, cette épicerie du coin n’est absolument pas bâtie dans le coin de quoi que ce soit. C’est juste une devanture entre deux autres, comme partout sur la planète. Sauf qu’ici les Arabes sont Mexicains. Haha.
Ma première décision c’est de l’eau vitaminée vitamin water. La couleur des bouteilles me fait presque triper. Ce con de Warhol n’avait pas tellement tort. Ses formes et ses couleurs. Ses reproductions massives ou décalées. Autant de boîtes de soupes à la tomate. Autant de bouteilles de vitamin water. J’opte pour une violette.
Sur l’étiquette : Fruit. Punch. Revive.
Vendu. Le truc est probablement si chimique qu’il pourrait, effectivement, reviver un mort…
…reviver… ça me rappelle quand j’avais quatorze, ou seize ans et que je fréquentais à tour de rôle cour d’école et télévision, la vague d’humoristes et de journalistes sérieux qui s’en étaient pris à Jean-Claude Vandamme et ses anglicismes… Quand je rentre au pays, on me trouve un drôle d’air et ma syntaxe fait rigoler la ménagère. Personne ne comprend que mes anglicismes sont un enrichissement. Que la langue française est si sclérosée, stagnante qu’elle en devient puante et marécageuse. Mes anglicismes qui font rigoler la ménagère sont une expérience augmentée de la langue. C’est un télescopage poétique de mes deux demi-mondes. C’est mon pouvoir absurde de pouvoir tisser deux langues et leurs mondes entre elles et de toucher du bout du doigt le sacré de la parole…
Faut que je bouffe quelque chose. L’arabe-mexicain du coin calé entre deux façades vend aussi des nouilles chinoises à emporter.
TAKE-OUT.
Apparemment quand je marche on dirait que je cours. Mes translations corporelles d’un lieu à l’autre se doivent d’être rapides et présentes. Une nana un peu barge, intervenante en théâtre, qui avait le Stanislavski qui lui titillait la glotte, m’a appris, la dernière année des années quatre-vingt-dix, ce qu’est le charisme. Le charisme c’est pouvoir marcher en ligne droite au milieu d’une foule, sans s’excuser, ni pousser les êtres autour de soi.
Depuis que madame Stanislavski m’a dévoilé sa théorie, je n’ai pas mis longtemps à comprendre l’essence même du charisme. Le charisme : c’est marcher vite. (Même quand on ne marche pas.)
Si on marche vite, c’est qu’on a quelque part où aller, que quelqu’un nous attend quelque part, qu’à chaque instant, on se trouve au milieu de deux lieux. Celui où l’on est et celui où l’on va être.
Marcher vite c’est être quelqu’un, exister. Cela n’a absolument rien à voir avec une question de vitesse. Absolument.
La seule raison pour laquelle j’existe, moi, c’est parce que quand je marche on dirait que je cours. Sans ça, je ne suis rien.
J’ai deux problèmes dans la vie.
- J’ai des voix dans la tête.
- J’ai largué les amarres.
À cause de ça, je me raconte des histoires. En permanence. Cela a commencé depuis toute petite. Le monde ne me convenait pas, alors je prenais des libertés avec lui. Bien sûr les adultes responsables autour de moi ont essayé de m’inculquer une éducation, des manières et des valeurs. Je n’ai pris que ce qui m’arrangeait.
Très tôt, je me suis inventé une vie et l’ai clamée sur la place publique. J’étais l’aède de la cour d’école, comme un petit vampire de cinq ans assoiffée de reconnaissance et de gloire.
Bien sûr, rien de ce que je raconte(ais) n’était vrai. Mais c’était toujours suffisamment vraisemblable pour que je sois une sorte de working class hero.
Alors, à force de me raconter des histoires j’ai continué, et les voix s’en sont donné à cœur joie.
Ma relation d’illusion - désillusion vis-à-vis de moi-même c’est entre toboggan et dents-de « si ». Et aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu, dans mes poches, au fond de la tête et sur le bout de la langue, des demi-mondes peuplés de MOI et mes clones qui s’activaient à donner du sens à ce monde édenté.
Tara doit être en train de s’amuser. Je me sens creuse ce soir. Il s’est encore passé quelque chose de bizarre. Encore un coup de H dans ma vie. H c’est une de mes plus belles et affreuses histoires. Un de mes chefs-d'œuvre d’imagination qui me fait frémir de vie et de mort chaque fois qu’il fait un happening dans mes songes.
H c’était coffee and cigarettes. Philo à quatre heures quarante-huit du matin. Crises existentielles entre deux oreillers parce le cœur a ses raisons que mes histoires embrouillent. Beat and Punk. Littérature et Fiction. Sushi & London. X& Y.
H, c’est mon expérience la plus physique et sourde d’un morceau d’Explosions in the Sky. H, c’est mon éloge de la folie. H, c’est mon effet de style qui stoppe NET
et là il faut se relever, recommencer pas à pas
chasser le chagrin, accepter la fin de l’album, la dissolution
du groupe, les carrières individuelles de chacun, les albums solo, brillants pour certains, inachevés pour d’autres, les envie de mourir
de ne plus croire en sa basse, en son synthé, en sa veste à paillette et ses rails de coke
pré-tracés dans la loge, à côté du panier de fruits et des chaussettes propres d’après le show.
H. C’est mon histoire. D’amour ? actually...
. . .
Le problème avec le tatouage c’est que je ne pas comment m’y prendre pour l’enlever.
Le problème avec le tatouage c’est que je n’ai aucune idée des conditions dans lesquelles il a été fait.
Probablement les meilleures conditions d’hygiène, et une maturation du projet artistique certaine. Cela ne fait aucun doute. Probablement par un artiste de talent. Ça ne fait aucun doute.
Il faut que je vérifie si j’ai payé pour ça.
Il faut que je pense à ma prochaine étape.
…
La soupe a un fort goût d’olive ce qui me fait rire. Je me suis installée au mini-comptoir de la supérette, à l’abri du vent, des SDF, des brigades anti œuf-durs. C’est la première fois que je mange une soupe chinoise goût olive. C’est pas dégueulasse et ça ajoute une petite note d’ironie tragique à ma déconvenue géographique faciale. Comme une bouffée de Provence, en bouche, absurde, tenace et nourrissante. La soupe me rassérénère, m’attrape par la cheville et me fait redescendre sur terre. J’ai envie d’engager la conversation … j’avais envie de dire bonjour à n’importe qui … n’importe qui, et ce fut … le mec qui m’a servi la soupe minestrone-chinoise, et je lui ai dit n’importe quoi … on n’a pas chanté, on n’a pas dansé et on a certainement pas pensé à s’embrasser !
Un autre épisode. Un peu plus au nord. Un bon moment plus tard.
Je pense que le groupe va être bon ce soir. T et moi nous sommes parées de nos plus belles loques. Elle est ravissante. Je suis… émerveillée par sa présence, mais il m’est difficile de m’approprier la mienne. Quand il s’agit du corps et de ses multiples représentations, j’ai du mal à ne pas osciller. Du tout au tout, je suis, ou bien la plus belle et la plus désirable, ou alors la pire des fraudes, l’indésirable, l’ennuyeuse. Celle qui ferait souhaiter à n’importe qui du sexe masculin la dissolution de sa courbe oculaire, tellement je suis riche en platitudes. Ce soir je suis belle, parce que T. est belle et que dans le monde où nous vivons, il est impossible qu’une fille si belle puisse s’acoquiner avec une moins que rien. Je suis belle donc, et ça se sent. Ma certitude nocturne, boostée au mascara ultra-long et au gin and tonic, me fait bouillonner le charisme et j’investis les lieux à coups de rouge lippu, d’éclats de rire qui tintent l’air d’une fraîcheur garce et champêtre, et de grands gestes dramatiques.
On est dans une petite salle de concert, bourrée de monde, et un groupe local de bluegrass s’apprête à faire vendre des micro-bières organic au patron et nous faire taper de la santiag. Ils sont trois, dans leur accoutrement de vingtaine bûcheronne exigé des jeunes hommes du début de nos années 10. Au moins deux d’entre eux ont barbe et/ou moustache, ainsi qu’une pinte de bière aux arômes subtils de café, clous de girofles, trèfle à quatre feuilles, tomate cerise et quelque chose comme Dieu, là aux pieds de leurs instruments. A leurs pieds à eux, 6 unités de chaussures de randonnée, de couleurs, tailles et densités de boue variables, et une bonne quantité de nombrils, couverts eux aussi de l’unanime chemise de bucheron. Je papillonne, boit mon troisième gin and tonic à la paille, souris, touches les épaulesviriles autour de moi et je taquine, coquine, la masculinité qui m’entoure. Je suis pompette et quand je suis pompette, comme par un paradoxe intellectuel, ou peut-être simplement pour pallier la défaillance momentanée de mes fonctions analytiques, je ressens le besoin primaire de débattre de sujets philosophiques avancés. Alors que j’essaie d’exposer ma vision anti-saussurienne du langage et des vertus communicatives du langage à un gars mal à l’aise à qui je ne plait probablement même pas, et qui est juste là pour écouter un peu de musique et pour une bière dans son bar préféré, un type s’approche et entre dans mon monologue.
- …donc tu vois, si on pense le langage comme la seule structure qui nous permet d’or-ga-ni-ser notre magma de pensée et de l’extérioriser, ça présuppose que rien ne nous est possible en dehors du langage ! Et ça tu vois, j’arrive pas du tout à le concevoir, c’est comme si par exemple tu prenais un oiseau dans une cage … L’oiseau tu vois, il …
- … excuse-moi, je n’ai pas pu m’empêcher de t’écouter parler, de regarder tes mains, et de sentir ton intensité. Tu es tellement belle… Mais ah, oh, désolée, je ne voulais pas t’interrompre, tu parlais de Saussure, c’est ça ? Ah le langage ! Ahah. Quel vaste sujet.
- …
Je suis pompette, joyeuse et j’aime tout le monde. Son intervention me flatte. Ses commentaires encore plus. J’esquisse un demi-sourire, je finis mon verre et je dis
- … Ahah, j’ai fini mon gin and tonic. Apparemment leur vin est super bon! J’ai entendu des merveilles du pinot noir de l’Oregon. C’est vrai ? Tu comprends je suis française, alors j’ai grandis dans la tradition du bon vin. C’est naturel chez moi. Je suis une œnologue de naissance, sauf que moi, j’avale ! Ahah
Pour parfaire mon intervention, je relève légèrement le menton, secoue la tête, lève les yeux au ciel et lui touche l’épaule. Il me commande immédiatement un verre de vin.
- Oh, merci ! C’est tellement gentil. Il ne fallait pas ! Je te paye le suivant !
Je lui touche à nouveau l’épaule et lui dit que je reviens dans un instant. Je pars à la recherche de T. J’ai envie d’une cigarette, et j’ai envie de la voir. Je l’aime tellement. Elle me rend belle et exotique. Je la trouve sur une banquette un peu en retrait de la scène, au beau milieu de ce qui m’a l’air d’un groupe hétéroclite d’habitués. Elle est en train de raconter une histoire et les hommes qui l’écoutent sont vraisemblablement ravis de l’expérience audiovisuelle que leur offre la petite blonde à l’accent australien. Ils rient aux éclats, elle fait semblant de se fâcher et faire la moue, mais ne tarde pas à prendre part à l’euphorie de sa clique nouvellement constituée. Elle m’aperçoit, se lève et m’attrape la main.
-Guyyyyyyyys ! This is Shay ! On s’est rencontrées à S.F !
Je serre la main des acolytes du moment de T, à grands coups de nicetomeetyous et de sourires ravageurs. Mais j’ai envie de fumer une cigarette, pas de faire des mondanités :
-Hey T., t’as envie d’une clope ? J’y vais.
- Oh non, ça va. J’irais à la prochaine.
On se sourit, je sors, une clope pas encore allumée entre mes lèvres rouges London.
Je n’ai stratégiquement pas de feu, sauf que personne n’est à l’extérieur. Je cherche sans grande conviction dans mon sac, plonge le nez dans mes affaires et farfouille. Rien. Je relève la tête et attrape la poignée de la porte, qui s’ouvre sans même que je ne la presse.
Le type du vin rouge est là. Pas vraiment grand, typé irlandais ou belge. Mais petit. Il porte une parka grise, une chemise noire avec une cravate noire. Assez élégant, bien que je pressente que ce n’est pas là sont habit de prédilection. Sans vraiment en posséder aucun des signes distinctifs, si ce n’est peut-être la coupe de cheveux, il a l’air d’un individu radical. Le genre de gars qui a passé les trois premières années de sa majorité, si ce n’est pas avant, à vivre dans une communauté hippie, un squat ou une roulotte, à explorer, selon le continent, les grands parcs nationaux, les réserves natives américaines, la Moldavie occidentale ou Lettonie. Il y a quelque chose dans ses yeux. Une profondeur un peu cruelle. Mais ses joues sont roses et ses lèvres pleines et brillantes. Il me sourit. Je l’aime instantanément.
-Ah ! Salut monsieur vin rouge ! Tu me suis à la trace, à ce que je vois… Impressionnant.
- Non, je venais juste fumer une cigarette.
- Tiens, moi aussi, mais je n’ai pas de feu.
Il m’allume, je l’allume. Échange de bons procédés. Nous fumons.
Il me touche l’épaule lui aussi :
- Edward.
- Shay.
- C’est ton vrai prénom, Shay ?
- Non.
- Tu viens ici souvent ?
- Non. Et toi ?
- Je vis juste à côté.
- Ahah. On va chez toi ?
- Je suis marié (il sourit).
- Ah.
- Oui. Je suis marié et j’ai trois enfants. Deux, quatre et six ans. Mais on va chez toi, si tu veux.
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce que tu es marié. Je ne voudrais blesser personne. Pas piétiner le sacré.
- Je vis dans une union libre. Ma femme a un petit-ami. Moi, non. Qu’est-ce qui t’amène par ici Shay ?J’ai écouté ce que tu avais à dire sur le langage, tu sais. Sur Saussure. J’ai sursauté de ta profondeur. Elle est bien plus belle et intense que ton rouge London et ton rire cristallin.
Je suis estomaquée. Interloquée. Dumbfound. Je ne sais pas quoi dire alors je fume, je me perds dans le silence, dans ses yeux. Je le laisse embrasser mon âme, mes profondeurs. Je le laisse caresser mes abymes et me dire sans mots l’éternel en moi.
Nous fumons, en silence. Dans la fraîcheur mouillée de cette première nuit à Portlandia. Le concert a commencé, les cris de joie et de soutien au groupe se font entendre, étouffés par la lourde porte de bois et les doubles vitrages. Mais j’allume, en silence, une deuxième cigarette. Lui aussi. Il me prend la main et m’emmène marcher. Je me laisse faire. Je ne crains rien. Je ne parle pas, je ne pense pas. Impressionnée par cette promenade lunaire avec un inconnu. Songe d’une nuit d’automne. Notre silence nous fait frôler l’ineffable, annule tous les gin and tonic, éteint mes voix intérieures, les singes et la sorcière. Sa main tient la mienne avec une douceur joyeuse et mes doigts tenus au chaud, immobiles dans sa paume, ont pleine conscience de la totalité de son corps. Notre communion nous mène jusqu’au musée d’art moderne. Les spots de la cour intérieure tamisent la nuit. Et au milieu, un cheval de bois.
L’apparence tortueuse des morceaux de bois, tels de longs doigts noués, faits d’échardes qui soutiennent une carcasse de cheval rongée par les apparences et les mythologies que l’Homme lui a prêtées m’interpelle. Le bois, quelle matière noble et friable, si sujette aux intempéries et difficile à travailler. Comment la sculpture, l’assemblage de bouts de bois, peut-elle survivre à la pluie abondante de la ville ? Comment cette carcasse ne gonfle-t-elle pas, n’implose-t-elle pas émoussée, de l’intérieur par tant de particules de gouttes ? J’adresse mes questions à demi-voix, fascinée par la lune et le squelette chevalin, ma main, adoucie par la présence de l’autre, et elle flotte un instant. Un instant, j’ai les idées au bord des lèvres, le cœur accroché à mes mots, je suis liée à travers grille et convention, à Lui et à cette œuvre.
C’est le moment qu’il choisit pour m’embrasser, pour lancer un exutoire à ma chamade.
Évidemment, tout se met à tourner, Hermès me chausse de ses souliers éthérés et les afflux reflux de mes intérieurs se font post-rock et symphonie. Le monde se joue de nous, et nous nous nouons à petit feu. Ce baiser est une affaire de main. In médias re et en chanson.
Mais voilà. Le bois n’est pas du bois. C’est du Bronze. L’âge d’homme. Dommage. Tout aurait pu être si bien, si doux. Rencontre archétypale. Mais je me sens trahie. Il a fait le mauvais choix. Le trident de sa destinée l’a écarté de la mienne, en une fraction de mots. Dire avant d’agir, avant d’entremêler les âmes, ne pas agir, se taire.
- I love you.
- Moi aussi. Je t’aime.
Il me serre contre lui, mais tout est déjà pourri. J’ai envie de le pousser, de partir, de retrouver Tara, de crier, de pleurer et de griffer le monde. Je m’en veux de ce corps, de cette voix, de ce langage, qui fait et dit toutes ces choses à mon encontre. Mes bras se crispent, il resserre son étreinte. Je l’aime tellement, in médias re. Sartre me chuchote ses mots et sa nausée et je frémis de cette étreinte inattendue, touchant d'une main notre tombe et de l'autre notre berceaux.